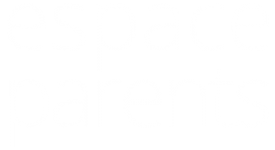Le collégial est un ordre d’enseignement qui se situe entre l’éducation obligatoire, constituée du primaire et du secondaire, et les études universitaires. Dans le système scolaire québécois, le collège est le premier lieu de formation non obligatoire et les choix de formation y sont personnels.
Qu’est-ce que le collégial?
DEC signifie diplôme d’études collégiales
Pour obtenir un DEC, un étudiant doit avoir atteint les objectifs de la formation générale en réussissant tous les cours suivants :
- 4 cours en langue et littérature (9 1/3 unités)
- 3 cours en philosophie (6 1/3 unités)
- 2 cours en langue seconde (4 unités)
- 3 cours en éducation physique (3 unités)
- 2 cours complémentaires (4 unités)
Avoir atteint les objectifs de la formation spécifique en réussissant l’ensemble des cours suivants :
- Les cours du programme préuniversitaire (de 28 à 32 unités) ou
- Les cours du programme technique (de 45 à 65 unités)
- Avoir réussi l’épreuve uniforme ministérielle en langue et littérature
- Avoir réussi l’épreuve synthèse locale propre à chaque programme
Pour une préparation à l’université
Au collégial, la formation préuniversitaire a pour objectif de fournir à l’étudiant les connaissances et les habiletés nécessaires à la poursuite d’études de premier cycle à l’université. Dans le cadre de son parcours collégial, l’étudiant apprend également à être autonome, à faire preuve d’une maturité et d’une ouverture sur le monde qui lui seront utiles quel que soit le programme universitaire choisi.
Programmes principaux
Les programmes d’études préuniversitaires conduisent au diplôme d’études collégiales (DEC).
Les programmes d’études préuniversitaires vous permettent d’obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) et de poursuivre vos études à l’université.
Plusieurs types de programmes s’offrent à vous :
- programmes réguliers;
- cheminements du Baccalauréat international (BI);
- programmes destinés aux autochtones;
- programmes de langue seconde enrichie;
- doubles cheminements.
Principaux programmes d’études préuniversitaires
Arts, lettres et communication (500.A1) (PDF 1.33 Mo)
Arts visuels (510.A0) (PDF 1.13 Mo)
Histoire et civilisation (700.B0) (PDF 767 Ko)
Musique (501.A0) (PDF 2.55 Mo)
Sciences de la nature (200.B0) (PDF 2.52 Mo)
Sciences de la nature (200.B1) (PDF 0.91 Mo)
Sciences humaines (300.A0) (PDF 2.18 Mo)
Sciences humaines (300.A1) (PDF 904 Ko)
Sciences informatiques et mathématiques (200.C0) (PDF 1.18 Mo)
Sciences, informatique et mathématique (200.C1) (PDF 868 Ko)
Cheminements du Baccalauréat International (BI)
Programmes adaptés aux langues et aux cultures autochtones
Programmes d’études avec langue seconde enrichie
Doubles cheminements
Les doubles cheminements sont des aménagements intégrés de deux programmes d’études préuniversitaires. Ils conduisent à deux DEC.
Arts, lettres et communication (PDF 1.17 Mo) et Arts visuels (PDF 1.13 Mo) (500.13)
Arts, lettres et communication (PDF 1.17 Mo) et Danse (PDF 1.55 Mo) (500.15)
Arts, lettres et communication (PDF 1.17 Mo) et Musique (PDF 2.55 Mo)(500.11)
Danse (PDF 1.55 Mo)et Arts visuels (PDF 1.13 Mo) (506.13)
Histoire et civilisation (PDF 767 Ko) et Arts, lettres et communication (PDF 1.17 Mo) (700.16)
Musique (PDF 2.55 Mo) et Arts visuels (PDF 1.13 Mo) (501.13)
Musique (PDF 2.55 Mo) et Danse (PDF 1.55 Mo) (501.15)
Sciences de la nature (PDF 0.91 Mo) et Arts, lettres et communication (PDF 1.17 Mo) (200.16)
Sciences de la nature (PDF 0.91 Mo) et Arts visuels (PDF 1.13 Mo) (200.13)
Sciences de la nature (PDF 0.91 Mo) et Danse (PDF 1.55 Mo) (200.15)
Sciences de la nature (PDF 0.91 Mo) et Musique (PDF 2.55 Mo) (200.11)
Sciences de la nature (PDF 0.91 Mo) et Sciences humaines (PDF 904 Ko) (200.12)
Sciences humaines (PDF 904 Ko) et Arts, lettres et communication (PDF 1.17 Mo) (300.16)
Sciences humaines (PDF 904 Ko) et Arts visuels (PDF 1.13 Mo) (300.13)
Sciences humaines (PDF 904 Ko) et Danse (PDF 1.55 Mo) (300.15)
Sciences humaines (PDF 904 Ko) et Musique (PDF 2.55 Mo) (300.11)
Sciences, informatique et mathématique (PDF 868 Ko) et Arts visuels (PDF 1.13 Mo) (200.17)
Découvrir la formation collégiale technique (MES)
Les programmes d’études techniques conduisent au diplôme d’études collégiales (DEC), délivré par le Ministère, ou à une attestation d’études collégiales (AEC), délivrée par un collège.
Secteur 1 : Administration, commerce et informatique
Secteur 2 : Agriculture et pêches
Secteur 3 : Alimentation et tourisme
Secteur 5 : Bois et matériaux connexes
Secteur 7 : Bâtiment et travaux publics
Secteur 8 : Environnement et aménagement du territoire
Secteur 10 : Entretien d’équipement motorisé
Secteur 11 : Fabrication mécanique
Secteur 12 : Foresterie et papier
Secteur 13 : Communications et documentation
Secteur 14 : Mécanique d’entretien
Secteur 15 : Mines et travaux de chantier
Pour être admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC), la personne doit avoir soit :
- un diplôme d’études secondaires (DES);
- un diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir réussi les matières suivantes :
- langue d’enseignement de la 5e secondaire;
- langue seconde de la 5e secondaire;
- mathématique de la 4e secondaire;
- une formation jugée équivalente par le collège;
- une formation et une expérience jugées suffisantes par le collège et une interruption des études à temps plein durant au moins 24 mois;
- 6 unités ou moins à accumuler pour l’obtention d’un DES, pour les titulaires du DEP, ou pour l’apprentissage d’une des matières suivantes :
- langue d’enseignement de la 5e secondaire;
- langue seconde de la 5e secondaire;
- mathématique de la 4e secondaire.
Pour certains programmes d’études collégiales, vous devrez aussi répondre à des exigences spécifiques au programme choisi.
Pour être admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC), vous devez répondre à l’une des conditions suivantes :
- avoir interrompu des études à temps plein ou avoir poursuivi des études postsecondaires pendant au moins deux sessions consécutives (une combinaison d’interruption des études et d’études postsecondaires est acceptée);
- détenir un DEP;
- faire l’objet d’une entente conclue entre l’établissement et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental.
Des activités de mise à niveau (PDF 471 Ko) peuvent être offertes pour permettre à un étudiant ou une étudiante de satisfaire à certaines conditions d’admission à un programme d’études conduisant au DEC ou à une AEC.
Des activités favorisant la réussite (PDF 471 Ko) peuvent aussi être offertes pour permettre à un étudiant ou une étudiante d’acquérir des compétences que le collège juge essentielles pour la poursuite de ses études collégiales.
Au cours du processus d’admission, les établissements d’enseignement se réservent le droit de fixer un contingentement local pour n’importe quel programme et d’appliquer des critères de sélection si nécessaire.
Cette sélection peut comporter des auditions, des tests d’habiletés, des tests physiques ou des entrevues.
Le cheminement Tremplin DEC a pour but de donner à l’élève une formation lui permettant d’intégrer ou de compléter un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC).
Les conditions d’admission au cheminement Tremplin DEC sont les mêmes que celles pour l’admission à un programme d’études conduisant au DEC.
Qu’arrive-t-il après le Tremplin DEC?
L’étudiant peut…
- poursuivre ses études dans un programme préuniversitaire ou technique.
- poursuivre ses études vers le secteur professionnel (DEP).
- intégrer provisoirement le marché du travail.
- participer à un projet de voyage.
- etc.
Cégeps publics et collèges privés
C’est simple, pour les institutions publiques, il suffit de présenter une demande au Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), au Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ) ou au Service régional de l’admission des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL), selon la région où se trouve le cégep désiré.
Pour faire une inscription dans un collège privé, il faut visiter le site Internet du collège souhaité. Il est possible de consulter la liste des collèges membres sur le site de l’Association des collèges privés du Québec.
Le 1er mars
C’est la date limite pour produire une demande d’admission. Une seule demande est acceptée par service régional d’admission. Pour ce qui est des institutions collégiales privées, l’élève peut faire plusieurs demandes. La date limite pour le premier tour des admissions est le 1er mars de chaque année, et viennent ensuite les 2e et 3e tours en avril et en mai pour les élèves qui auraient eu des refus au premier tour.
Liste des institutions publiques et privées
- Liste des cégeps du SRAM
- Liste des cégeps du SRACQ
- Liste des cégeps du SRASL (dans le menu à votre gauche)
- Liste des collèges privés au Québec
L’attestation d’études collégiales (AEC) est la sanction attestant la réussite d’un programme à durée variable élaboré par le collège, aussi appelé « programme d’établissement ». Les programmes d’établissement visent à répondre rapidement aux besoins régionaux de formation technique sur mesure.
Les conditions d’admission ne sont pas les mêmes que celles du diplôme d’études collégiales. Les élèves qui terminent leurs études secondaires ne sont généralement pas admissibles. Pour connaître les conditions d’admission, il faut vous référer à l’établissement où se donne le programme désiré.
La formule DEC-BAC résulte d’une entente entre une université et un cégep. L’université reconnaît des acquis du programme du collégial pour l’équivalent d’une année d’études universitaires et dans certains cas d’une année d’études collégiales. Cela permet d’obtenir, généralement en quatre ou cinq années d’études, une double diplomation.
Voir la liste des programmes offerts selon la formule DEC-BAC
Au collégial
- Les stages en entreprise sont majoritairement de longue durée (de 8 à 16 semaines consécutives).
- Les stages s’ajoutent aux heures du programme d’études, ce qui a pour effet de prolonger la durée de celui-ci.
- L’entreprise a l’obligation de rémunérer le stagiaire au moins au taux du salaire minimum en vigueur, puisque les heures de stage sont ajoutées à celles du programme d’études.
Les modèles peuvent toutefois varier selon les établissements scolaires et les programmes d’études.
Grâce à la concertation qu’elle exige entre le milieu du travail et l’établissement d’enseignement, l’ATE permet à l’élève d’acquérir ou de perfectionner les compétences nécessaires à l’exercice de la profession ou du métier qu’il ou elle a choisi.
Visiter la page de l’Inforoute de la formation professionnelle et technique à cet effet
- La cote R est en fait la CRC, c’est-à-dire la cote de rendement au collégial.
- Les études collégiales doivent être prises au sérieux dès la première session, car le dossier scolaire sera évalué selon cette « cote R ». Cette méthode d’évaluation est utilisée par la majorité des universités québécoises afin de gérer l’admission dans certains programmes (ex. : médecine, pharmacie, nutrition, etc.).
La « cote » R expliquée
Selon la politique d’accès à l’information établie par le Comité de gestion des bulletins d’études collégiales (CGBEC), où siègent des représentants des collèges, des universités et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, l’étudiant qui désire obtenir sa CRC doit s’adresser à son collège ou à l’université où il a déposé une demande officielle d’admission.
Par ailleurs, pour obtenir toute information générale relative à l’utilisation de la CRC dans le cadre du processus d’admission, l’étudiant doit s’adresser à l’établissement universitaire où il a déposé ou l’intention de déposer une demande d’admission.
- Tableau comparatif des critères de sélection des candidatures évaluées sur la base du DEC aux programmes contingentés de baccalauréat, 2024-2025, 12 janvier 2024
- La CRC révisée et l’admission universitaire, 8 septembre 2022
- Cote de rendement au collégial (CRC) : calcul temporaire de la cote Z au secondaire, 5 juillet 2022
- Cote de rendement au collégial (CRC) : la mesure connue la plus équitable, 21 février 2022
- Remarques relatives à l’article « La cote R est très biaisée », 22 octobre 2020
- Questions et réponses sur la cote de rendement au collégial, 16 septembre 2020
- La cote de rendement au collégial : ce qu’elle est, ce qu’elle fait, 16 septembre 2020
- La cote de rendement au collégial : aperçu de son rôle et de son utilisation, 16 septembre 2020
- La CRC actuelle : fondements – Brève présentation, 8 octobre 2019
- La cote de rendement au collégial : modifications à compter du trimestre d’automne 2017, 16 juin 2017
- La cote de rendement au collégial : ce qu’elle est, ce qu’elle fait, 4 mars 2013
Voici un outil qui facilite la compréhension de la cote R. Plusieurs vidéos du genre existent, ce n’est qu’un exemple pour rendre plus accessibles les éléments qui la composent.
Inspiré du site du ministère de l’Éducation.